
L’insigne du RSMA-Pf s’inspire de l’emblème de la Polynésie française créé le 4 décembre 1985.
Posé sur une ancre d’or symbolisant son appartenance aux troupes de marine y figure une pirogue double polynésienne et sa voile, de couleur rouge, ainsi que les deux figurines de proue et des cinq motifs posés sur la plate-forme transversale représentant les cinq archipels de la Polynésie française : archipel des Australes, archipel des Gambier, Archipel des Tuamotu, Archipel des Marquises, Archipel de la Société.
Le champ supérieur de la pirogue est chargé de dix rayons de couleur d'or symbolisant le soleil, signe de vie. Le champ inférieur est chargé de cinq rangées de vagues bleu azur, la mer étant le signe de l'abondance. On peut également y lire les inscriptions RSMA et POLYNESIE.
Apparu chez les cavaliers Scythes il y a plus de 2000 ans, le bonnet de police est issu des premières coiffures portées par les Dragons au début du 18e siècle. Il en conserve la dénomination "à la dragonne" jusque sous la Restauration, vers 1830.
Les bonnets apparaissent très tôt également dans les vieilles Troupes de Marine puisqu'ils figurent sur les gravures du 18e siècle. Au milieu du 19e siècle, ils sont semblables aux modèles de l'armée de terre (modèle 1860 supprimé en 1868).
En 1897, l'Armée de terre adopte un bonnet de police dit "de forme serbe" puisqu'il copie le modèle de l'armée serbe. En 1899, les Troupes de marine adoptent à leur tour ce modèle moderne qui devient le bonnet de police. Pour se distinguer des autres armes, les Coloniaux prirent l'habitude de rentrer les pointes du calot : le "pipoter".
Les calots des Troupes de marine ont été coupés dans un drap bleu marine bordés ou passepoilés rouge et ornés d'une ancre de marine, le plus souvent en métal. L'ancre de marine peut aussi être brodée.
Les Marsouins et les Bigors ont pour saint patron Dieu lui-même. Ce cri de guerre termine les cérémonies intimes qui font partie de la vie des régiments.
Objet de marine connu depuis la plus haute antiquité, l'ancre devient le symbole de l'espérance avec les premiers chrétiens. Elle apparaît sur les uniformes des marins français dès la fin du XVIIIe siècle. Les Troupes de marine l'adoptent au même moment.
Aujourd'hui l'ancre d'or est l'unique signe distinctif des Troupes de marine. Qu'ils servent dans l'infanterie blindée, mécanisée ou parachutiste, dans les transmissions ou dans l'artillerie, tous les marsouins et bigors arborent depuis 1990, sur leur tenue Terre de France, l'ancre d'or sur fond bleu marine. Au sein, des armées ce symbole est renforcé depuis que la Marine nationale a abandonné l'ancre comme logo pour la remplacer par la proue bleue blanc rouge d'un navire de guerre.
Avec ou sans câble, avec ou sans numéro d'unité, avec ou sans bombarde, avec ou sans grenade, associée ou pas à une chimère... l'ancre s'impose toujours comme le symbole d'une culture d'arme, liée entre autres au rêve d'aventure, aux lointains horizons, à la connaissance de l'étranger bref, à l'image des soldats d'élite appelés par devoir sur tous les points du globe.
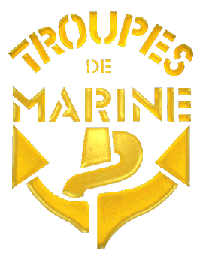
L'Arme des Troupes de marine est la seule à posséder un logo qui lui soit propre. Ce signe distinctif se retrouve autant dans les publications, que sur les matériels dérivés....
Elle est rouge. Elle était autrefois, en principe, la couleur spécifique des troupes indigènes.
Ce sont le bleu et le rouge. On les trouvait dans la vieille tenue de l'infanterie de marine. Elles sont conservées sur les fanions et sur les écussons.
La légende voudrait que l'hymne de l'infanterie de marine fût chanté pour la première fois sous les murs de Sébastopol, sur les rives de l'Alma ou près du moulin de Malakoff. En réalité, c'est à titre rétroactif que les marsouins incorporent les faits d'armes de leurs Anciens, de Crimée en Afrique, via Bazeilles, dans un chant de marche écrit en 1896.
Le chef de fanfare s'appelle Paul Cappé. Après un contrat de trois ans au 1er Étranger à Sidi Bel Abbes, il est admis comme compositeur à la SACEM avant de rengager au 1er de la Marine en 1894. Muté au 3e de l'Arme à Rochefort, il y écrit la musique de l'hymne. C'est lui qui met en musique le poème du général Frey. Rapidement diffusé dans toutes les compagnies de marine, le chant de marche devient hymne, poème lyrique et épique à la gloire des héros du passé et de l'avenir. Les marsouins et bigors d'aujourd'hui continuent à le chanter sur tous les théâtres d'Afrique, des Balkans et d'ailleurs. Tant qu'il restera des batailles et des tempêtes, la France aura besoin de ces hommes de fer que rien ne lasse, au coeur de matelot et de soldat.
Ce chant ne s'exécute qu'au "garde-à-vous", à un rythme enlevé, comme la musique de marche :
Elle est célébrée à l'occasion de l'anniversaire des combats de Bazeilles. Ce village qui a été 4 fois repris et abandonné sur ordres, les 31 août et le 1er septembre 1870.
A cette occasion, le récit du combat de la division bleue du général de Vassoigne est évoqué avec solennité et notamment l'épisode de l'épicerie Bourgerie, la fameuse maison des "dernières cartouches".
"La Division Bleue" - Pourquoi bleue ? C'est une référence à leur tenue. Alors dépendants du ministère de la Marine, tous les personnels portaient une tenue bleue (de la Marine) tandis que ceux de l'armée de Terre (dépendant du ministère de la Guerre) étaient dotés de tenues plus voyantes.